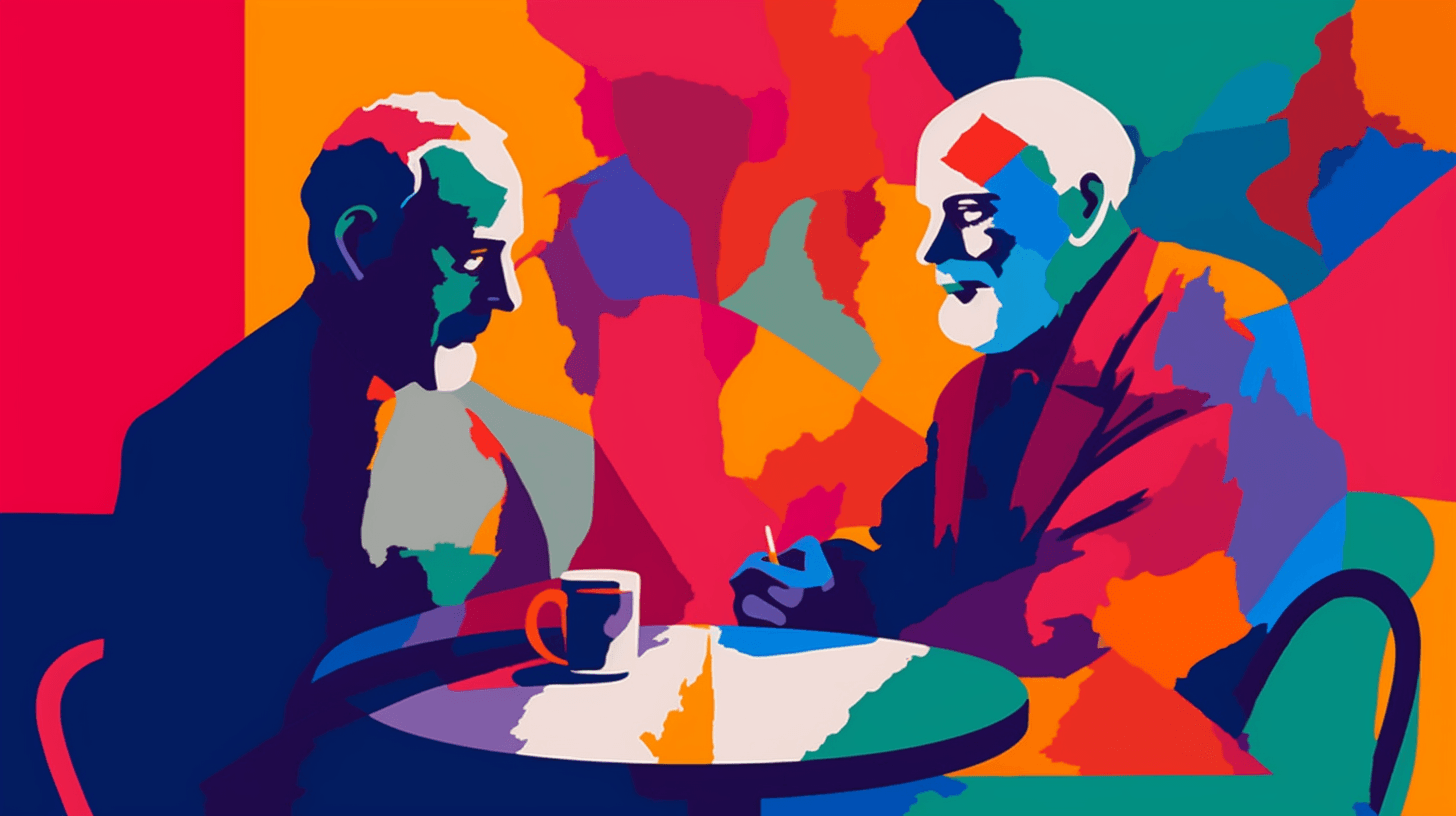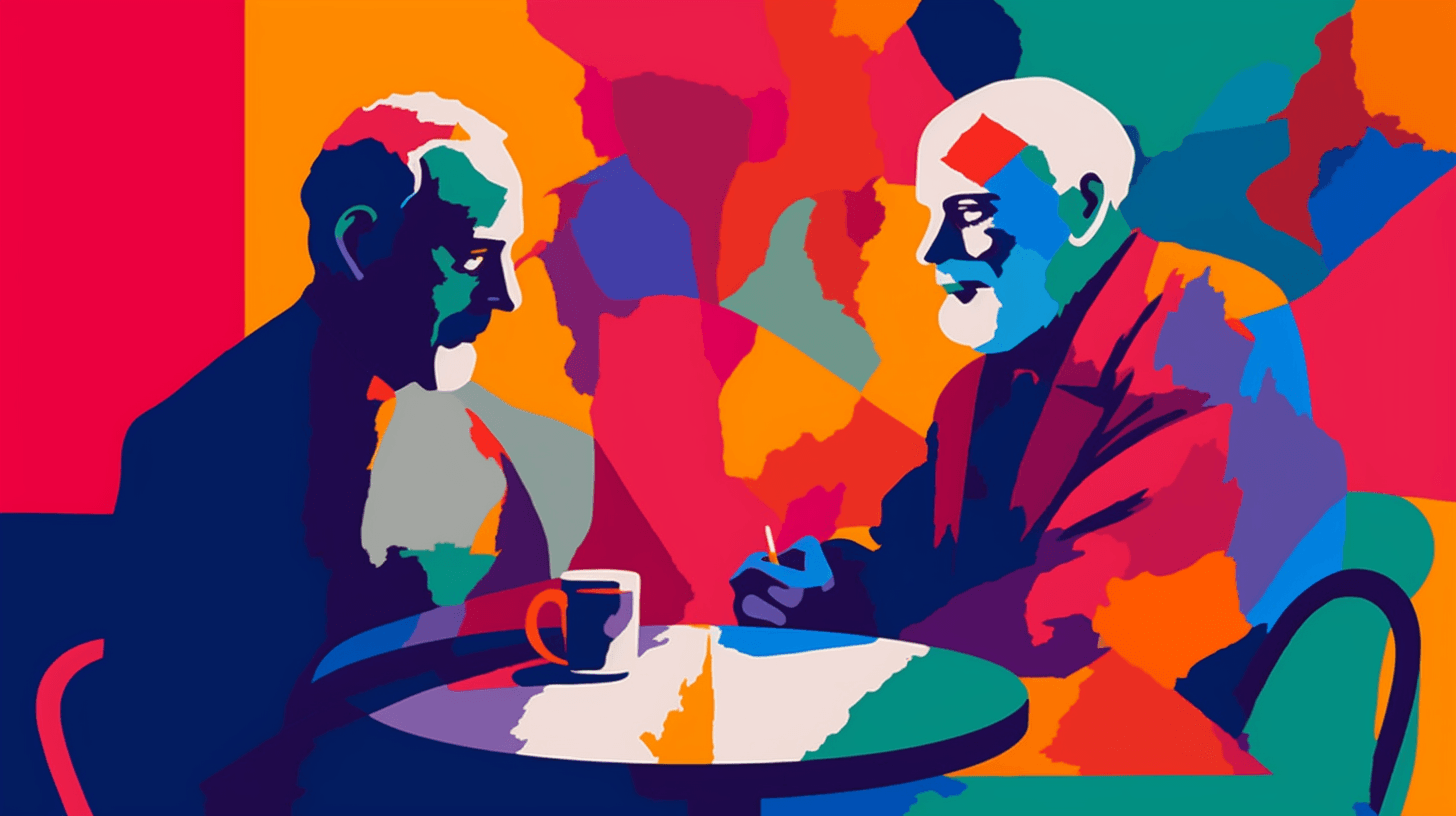
Qu’est-ce qu’une psychanalyse ? À bien y réfléchir, il ne s’agit nullement d’une expérience intellectuelle où par quelque procédure viendrait à être connu quelque scène ou propos oublié dont la remémoration, tel un viatique, garantirait l’analysant d’être affranchi des embûches du symptôme. Cette conception naïve a pourtant la vie dure, elle est même le ressort de la plupart des demandes d’analyse.
Bien au contraire, une psychanalyse est une mobilisation effective, in concreto, de la jouissance.
Mais qu’est-ce que la jouissance ?
Que nous ayons pris l’habitude de nous situer à partir des notions d’être ou d’existence ne leur enlève nullement leur caractère général et vide quand le terme de jouissance nous parle directement et renvoie à notre manière concrète de tirer profit de notre vie. « Nous ne savons pas, précise Lacan, ce que c’est que d’être vivant sinon seulement ceci, qu’un corps, cela se jouit.
Mais, pourquoi utiliser le concept de jouissance quand nous disposons de celui de plaisir qui, de surcroît, est le plus utilisé, die Lust, par Freud ? Certes, nous savons quand nous éprouvons du plaisir, mais nous ne pouvons en préciser la cause, même si nous la situons du côté de l’objet, selon le schème des morales hédonistes ou du syllogisme pratique : si je me dirige vers un objet, c’est que cet objet répond à mon attente.
Or, très tôt, dès le 5 octobre 1895, Freud souligne que l’expérience de satisfaction ne repose pas tant sur la disponibilité d’un objet que sur « l’attention d’une personne secourable (qui est ordinairement l’objet désiré, das Wunschobjekt). Ce n’est pas l’objet qui importe, c’est la « personne » susceptible de l’apporter qui a ainsi le statut d’objet désiré.
Mais, dix jours plus tôt, lors de la narration du cas d’Emma Eckstein, Freud a déjà démonté le rapport à la « personne secourable ». Le lecteur se souvient du symptôme de cette jeune femme : elle ne peut entrer seule dans une boutique, est tout à fois susceptible d’offrir l’objet attendu, les friandises, mais de manifester une demande, ici directement sexuelle, que l’enfant non seulement ne lui refuse pas, mais consent à agréer au point d’y retourner. Cinq ans plus tard, à treize ans, face à deux commis rieurs dont l’un suscite son attirance, elle est à nouveau confrontée à ce qu’elle suppose être une demande de l’Autre et un « trop de plaisir » l’oblige à fuir.
Ce même jour, Freud distingue la scène la plus ancienne dite A de la scène la plus récente dite B, en appelant la seconde le substitut, das Substitut, le symbole, das Symbol, de la première : seule, entrer dans, homme riant, deux, vêtement, etc., pouvant laisser subodorer une scène plus ancienne encore renvoyant à quelque premier Autre : de souhaiter quelque satisfaction orale, des friandises ici, confronte l’enfant à la demande de l’Autre.
Relisez la scène de Du côté de chez Swann, le narrateur précisant même qu’il en a souvent aperçu « sur les tablettes des pâtissiers », mais la demande de l’Autre, d’abord celle de tante Léonie puis celle de sa mère qui, contre l’habitude du narrateur, lui fait prendre un peu de thé.
Quoi que nous en pensions, ce n’est pas tant l’objet de la pulsion qui compte, friandises, petite madeleine amollie dans le thé, que, comme l’indique Lacan, la demande de la « personne secourable » sous les traits du « signifiant » qui la représente et dont l’objet n’est que le référent.
La pulsion ne se satisfait pas tant d’un objet que du « signifiant » de la demande de l’Autre, précision que corroborent les propositions de Wittgenstein et Quine : nous n’avons pas d’accès direct à l’objet, il nous est donné par le langage. La pulsion se satisfait des mots de l’Autre.
Il n’y a donc pas d’harmonie entre la pulsion et son objet et il n’y a donc ni perfection ni excellence en matière de plaisir, tout simplement parce que la visée de la pulsion n’est pas la réalisation d’une fonction biologique, mais la satisfaction de la demande de l’Autre. Le plaisir est ainsi un principe toujours déjà corrodé par l’impossibilité de sa réalisation et l’obligation de sa répétition, et s’il est toujours déjà jouissance, c’est qu’il prend ses conditions non auprès d’un objet, l’objet précise Freud est indifférent, mais auprès des « signifiants » de la demande de l’Autre.
La visée de la pulsion n’est donc pas le plaisir, mais la jouissance, si l’on veut bien entendre par ce terme la modalité propre à chacun d’exister, si exsister, c’est se situer au regard de l’Autre.
La langue le dit : le terme : « jouissance » vient du grec gethéo, je me réjouis, mais contient aussi l’idée de tirer profit d’une situation : tirer profit de la reconnaissance de l’Autre.
Aussi, que la plupart du temps Freud utilise le mot Lust et non celui de Genuss, ne doit pas nous troubler, même s’il utilise aussi le mot : « jouissance » dans l’article de 1896, écrit directement en français, où il forge le néologisme de psychoanalyse.
L’important, c’est que dès le 5 octobre 1895, quand il décrit l’expérience de satisfaction chez le nouveau-né, il souligne d’emblée que ce mécanisme repose sur une « action spécifique » dont la possibilité nécessite d’attirer « l’attention d’une personne secourable ».
Mais, dans ce texte, Freud ne va guère plus loin. C’est en 1905, qu’il explicite en quelque sorte le ressort de la scène la plus ancienne du cas Emma : l’expérience de satisfaction, Befriedigungserlebnis, suppose non seulement la présence d’une « personne secourable », mais l’attente par cette « personne » d’un bénéfice de sa fonction.
L’enfant, souligne-t-il en 1905, est d’emblée un corps joui par l’Autre. « Les rapports de l’enfant avec les personnes qui le soignent, écrit-il, sont pour lui une source continue d’excitations et de satisfactions sexuelles partant des zones érogènes. Et cela d’autant plus que la personne chargée des soins (généralement la mère) témoigne à l’enfant des sentiments dérivant de sa propre vie sexuelle, l’embrasse, le berce, le considère clairement comme le substitut d’un objet sexuel complet.
L’expérience de satisfaction suppose et nécessite un plus à l’action spécifique de la réplétion pulsionnelle qui tient aux indices d’un plaisir indéfini dont bénéficie l’Autre. L’expérience de satisfaction prend ses conditions non pas auprès de l’objet du besoin, le lait maternel, mais auprès de la jouissance de l’Autre.
Continuons le texte de Freud : « Une mère serait vivement surprise si on lui disait qu’elle éveille ainsi par sa tendresse la pulsion sexuelle de son enfant et en détermine l’intensité future. Elle croit que ses gestes témoignent d’un pur amour asexuel, asexuelle « reine » Leibe, dans lequel la sexualité n’a aucune part.
L’apaisement de la pulsion appelle un plus de plaisir fourni et un plus de plaisir retiré par l’Autre, sorte d’entente dans le plaisir que Freud appelle la compréhension mutuelle. « La voie de décharge acquiert ainsi une fonction secondaire d’une extrême importance : celle de la compréhension mutuelle. L’impuissance originelle de l’être humain devient ainsi la source première de tous les motifs moraux.
L’objet désiré n’est donc pas tant l’objet du besoin que la « personne secourable » chargée de l’apporter et dont la réalité est divisée que la jouissance viennent de l’Autre. C’est parce qu’il y a du « désir » dans l’Autre que je me révèle désirant et c’est parce que la jouissance est d’abord du côté de l’Autre qu’elle vient de mon côté : « Le vrai sujet du désir, écrit Lacan, n’est autre que la chose qui de lui-même est le plus proche tout en lui échappant le plus.
La Chose n’est donc ni le vide de Lao-Tseu de l’expérience de la jouissance de l’Autre.
En un mot, la question n’est pas la satisfaction de la pulsion à l’aide de l’objet qui lui conviendrait le mieux, cette illusion de la tradition métaphysique a fait long feu; la question est de saisir que l’objet n’a de consistance qu’à travers le « signifiant » dont il est le référent et qui provient de l’Autre. L’objet ne vaut qu’à travers le « signifiant » qui indique la demande de l’Autre.
Or, c’est dans cette relation que l’enfant devient « visible » pour lui-même, à l’occasion de la rencontre d’un Autre qui lui demande de le faire jouir en jouissant de ses « signifiants » : c’est Emma acceptant d’un seul mouvement les friandises et la main de l’épicier rieur sur son sexe ou Proust acceptant contre son habitude une petite madeleine amollie dans le thé.
Quand l’enfant tète le sein de sa mère, ce plaisir inclut en lui le plaisir pris par la mère à être tétée. La satisfaction de la pulsion, ici la pulsion orale, a pour condition non seulement la présence de l’objet du besoin, le lait, mais du plus de plaisir tiré par l’Autre. Il y a fort à parier qu’une mère qui ne prendrait pas plaisir à donner la tétée éteindrait l’appétit de l’enfant. Si l’énoncé du menu et la présentation des mets contribue à faire venir l’eau à la bouche des convives, ce n’est pas au titre de l’esthétique, c’est au titre d’indice de la jouissance prise à leur confection par le cuisinier.
Reprenons, si quand la question de la jouissance apparaît sous la plume de Freud, dans l’Esquisse, c’est à propos de l’expérience de satisfaction de l’économie pulsionnelle, quand il y revient, dans les Trois essais, c’est pour souligner la fonction de l’enfant dans l’économie sexuelle de la mère. Quand l’enfant jouit sur le mode pulsionnel, la mère jouit sur le mode sexuel, ce qui signifie que l’enfant pour la mère n’est pas qu’une série de pulsions partielles, mais est aussi un substitut phallique.
La jouissance pulsionnelle de l’enfant est donc d’emblée organisée par les « signifiants » de la jouissance sexuelle de la mère.
Un analysant se mit tout à coup à siffloter en séance. Le titre de cette musique était venu incidemment à la séance précédente. Or, depuis que cette ritournelle le hantait, précisa-t-il, il était impuissant et satisfaisait sa petite amie par cunnilingus. Peu après, au cours d’un rêve surgit le mot « arçon » qui, après quelques associations gymniques, aboutit au sobriquet qu’utilisait sa mère pour l’appeler lorsqu’il était tout jeune enfant : « mon petit narçon ». La queue du « g » avait été coupée. À ce « signifiant » s’ajouta aussitôt la vision d’une scène au-delà de l’amnésie infantile : l’analysant se « voit » nourrisson, porté par sa mère sous les aisselles et bercé de bas en haut au rythme de la mélodie incriminée, énorme sexe dressé et masturbé. Le surgissement subreptice du titre de la mélodie dans le transfert avait entraîné le rappel de la rengaine, puis la production d’un rêve où s’inscrivait le mot : « arçon » renvoyant au « signifiant » : « narçon ». À la suite de mon intervention soulignant que la queue du g avait été ôtée, s’opéra une levée de l’amnésie infantile où apparut la scène de l’enfant réduit à la fonction d’appendice maternel, scène dont l’activation avant sa remémoration avait induit chez l’analysant une impuissance l’ayant conduit à satisfaire sa partenaire per os.
La jouissance pulsionnelle s’articule ainsi à la jouissance de l’Autre et l’inclut en elle comme sa condition tout en posant la question de la « mémoire » des affects.
Dans Pulsions et destins des pulsions, Freud évoque les trois destins possibles de l’affect : la conservation qui suppose l’association à une autre représentation, la transformation en son contraire et la répression. Cette dernière serait le véritable but du refoulement dont l’empêchement en déplace l’action sur la représentation. Dans la scène rapportée par Proust, le goût de pâtisserie amollie par le thé est articulé au « signifiant » petite madeleine prononcé par la mère et avant elle par tante Léonie. Dans la scène ci-dessus, où l’enfant de quelques mois, balancé de haut en bas, sert de godemiché à sa mère, le « signifiant » arçon vient directement de cette dernière. Mais, dans les deux cas, l’affect a été réprimé avec le « signifiant ». Ce n’est pas la vue de la petite madeleine qui fait revenir le « plaisir délicieux », le narrateur en a souvent aperçu sur les tablettes des pâtissiers, comme ce n’est pas la mélodie qui fait revenir chez mon patient le souvenir; c’est l’évocation du nom du gâteau ou du titre de la mélodie.
La mémoire de l’affect lui est donnée par le « signifiant » qui lui est associé et qui est un « signifiant » de la mère : la jouissance pulsionnelle est articulée aux « signifiants » de la jouissance de l’Autre. Freud le confirme dans un article de 1920 : « Sa libido, écrit-il au sujet d’une patiente, s’écoulait depuis les tout premiers temps en deux courants, dont le plus superficiel pouvait sans hésitation être appelé homosexuel. Il était vraisemblablement la continuation directe, non-modifiée, d’une fixation infantile à la mère.
Mais, entre les « signifiants » de l’Autre premier et ceux des Autres actuels subsiste un écart. « La pulsion refoulée, écrit Freud toujours cette année 1920, ne cesse jamais de tendre à sa complète satisfaction, laquelle consiste dans la répétition d’une satisfaction primaire. Toutes les formations substitutives et réactionnelles, toutes les sublimations sont impuissantes à mettre fin à son état de tension permanente. La différence entre la satisfaction obtenue et la satisfaction cherchée constitue cette force motrice, cet aiguillon qui empêche l’organisme de se contenter d’une situation donnée, quelle qu’elle soit, mais pour employer l’expression du poète, le « pousse sans répit en avant, toujours en avant » (Faust, I).
Ainsi, les modalités premières de la jouissance, nouées aux « signifiants » de la demande de la mère, ordonnent « sans répit » ses modalités à venir.
La jouissance pulsionnelle est le sol de toutes les déterminations, comme le précisera explicitement Freud en 1931 : « La phase préœdipienne de la femme atteint par cela une importance que nous ne lui avions jamais attribuée jusqu’ici. Comme cette phase permet toutes les fixations et tous les refoulements auxquels nous ramenons les névroses, il semble nécessaire de revenir sur l’universalité de la thèse selon laquelle le complexe d’Œdipe est le noyau des névroses.
Notre manière d’habiter notre corps dérive directement de notre jouissance pulsionnelle. D’où la raison du lamarckisme, et non du darwinisme, chez Freud : le « besoin » de Lamarck, « qui crée et transforme les organes, n’est rien d’autre que la puissance exercée par la représentation inconsciente sur le corps propre, dont nous voyons les vestiges dans l’hystérie.
La jouissance pulsionnelle, par sa tension « sans répit », ouvre une analogie avec le deuxième principe de la thermodynamique : elle serait la dépense d’énergie obligée de notre économie qui engendrerait l’accroissement irréversible de l’entropie brisant la symétrie temporelle. Le temps est orienté. Le temps n’est pas seulement le cycle des alternances du jour et de la nuit; il ne se réduit pas non plus à la temporalité où se succèdent rétentions de la mémoire et protentions de l’anticipation; il est la jouissance. Nous ne pouvons nous arrêter de produire de quoi faire exister l’Autre. Le temps objectif de la course des astres et le temps subjectif de la conscience sont des temps symbolique et imaginaire qui s’articulent au temps réel de la jouissance.
Ces trois points mettent en exergue la fonction centrale de la jouissance pulsionnelle : elle ordonne nos conduites à venir, elle conditionne la plasticité du corps et elle a pour fonction de nous situer au regard de l’Autre dans une temporalité réelle.
La jouissance est ainsi très proche de l’agieren, non pas l’acte, acte en allemand se dit Tat ou Handlung, mais, suivant son étymologie latine, agere, plutôt accomplir, exprimer par le mouvement. Toute modalité de la jouissance est de l’ordre de l’agieren. « Les motions inconscientes, écrit ainsi Freud, ne veulent pas être remémorées, mais aspirent à se reproduire; le patient agit ses passions… zwischen Erkennen und Agierenwollen, entre discernement et volonté d’accomplissement.
La jouissance ou l’agieren est la dépense que notre nécessité d’exister au regard de l’Autre implique comme le montrent les rituels obsessionnels ou les conversions hystériques orale de l’enfant a une autre portée que la satisfaction de la faim; elle se porte vers un au-delà du plaisir de la satiété et des sensations cœnesthésiques labiales et buccales. Elle veut répondre, pour reprendre l’expression de Lacan, à un « besoin » dans l’Autre. L’enfant mange pour nourrir sa mère.
La « pulsion » anale a une autre portée que la satisfaction de la défécation; elle contient un au-delà au plaisir de la rétention et de l’expulsion comme des sensations cœnesthésiques de la marge de l’anus. Elle veut répondre à la « demande » dans l’Autre. L’accès à la propreté est d’abord une requête de l’Autre, parfois formulée avant même que l’enfant ne puisse y répondre ou commandée sous une forme si impérieuse qu’il semble que cela seul importe à l’Autre, au point que les fèces deviendront le support de leur relation.
La « pulsion » scopique a une autre portée que la satisfaction de la vision; elle contient un au-delà au plaisir de la contemplation. Elle veut se voir dans le regard de l’Autre et répondre ainsi à sa « puissance ». Ne cherchons-nous pas toujours dans le regard de certains auxquels nous accordons quelque importance le reflet de notre existence ?
La « pulsion » invoquante a une autre portée que la satisfaction glottique et auditive; elle contient un au-delà au plaisir de l’expulsion et de la perception des sons. Elle veut s’entendre dans l’Autre et répondre à son « commandement ». Ne quêtons-nous pas toujours dans la voix de certains auxquels nous accordons quelque importance la satisfaction de nous avoir ouï ?
Dès la naissance, montrent les expériences de Spitz, l’enfant s’apaise à la vue du regard ou à l’écoute de la voix de sa mère. À deux semaines, il sourit à la perception de son bien-être; à trois mois, il sourit à la perception d’une intonation câline.
Reprenons la formule : l’enfant s’offre comme bouche à nourrir pour combler sa mère.
Or, nombre de mères rabattent la fonction phallique de l’enfant sur le remplissement d’un besoin imaginaire et attendent avant tout que leur enfant « mange », « profite » : une cuillerée pour papa, maman… Ce n’est pas la valeur phallique de l’enfant qui importe, c’est son comblement qui s’impose. L’enfant ne fait jouir sa mère que s’il mange, défèque… Il arrive même que la mère jouisse d’une relation hygiénique figée dans un rituel quasi obsessionnel réduit à la satisfaction des besoins « biologiques » pour légitimer la rencontre avec un Autre, déjà sous les traits d’un médecin.
Il y a donc entre l’enfant et sa mère un véritable « commerce », au sens de Montaigne, qui s’établit nécessairement dans l’excès, l’au-delà du principe de plaisir.
Si le symptôme est le « signifiant », entrer dans une boutique seule pour Emma, petite madeleine amollie dans le thé pour Proust, qu’il faut ajouter au principe de plaisir pour combler l’Autre, il n’en reste pas moins que sa répétition témoigne de son insuffisance : il manque toujours au symptôme quelque chose qu’on pourrait appeler avec Lacan le plus de jouir attendu par l’Autre.
La formule de la jouissance s’écrirait alors :
PP + S2 + a = J (A)
où PP désigne le principe de plaisir, c’est-à-dire l’objet de la pulsion : friandises, madeleine, S2 le symptôme, c’est-à-dire le signifiant de la demande de l’Autre : entrer seule dans une boutique, petite madeleine amollie dans le thé, et a le plus de jouir qu’il faut leur ajouter pour égaler J (A), la jouissance de l’Autre, et qui est de l’ordre du réel du corps.
Ainsi, la Patrie, qui est une entité abstraite, n’existe que par les guerres, les cérémonies, le drapeau, qu’on lui consacre et par un réel que chacun lui octroie : sa sueur, sa peau, sa vie, etc.
Ainsi, dans une relation sexuelle, il y a la manière de chacun de faire l’amour qui est son symptôme et quelque chose en plus : le tact de ses caresses, la douceur de ses baisers, la chaleur de son regard, la suavité de sa voix, ses sécrétions intimes, etc., qui sont autant d’éléments du réel du corps de chaque partenaire et autant d’illustrations de a.
Nous avons ainsi facilement le sentiment que l’Autre nous commande d’accomplir sa jouissance en produisant au-delà du symptôme un plus très corporel mais indéfinissable.
Il en est de même dans le protocole de la cure. Si le symptôme est ce qui y est d’emblée évoqué, il y est aussitôt additionné d’un plus : regard, voix, manière de disposer son corps, etc., le tout sur le mode de l’offrande faite pour appâter l’analyste, voire pour le combler, comme l’illustre cette séance du 22 novembre 1907 de la cure de L’homme aux rats.
« Le patient, tout en déambulant dans la pièce, conte un rêve où il est question du décès de la mère de son analyste, de sorte qu’il s’apprête à lui faire une visite de condoléances, mais craignant d’être saisi d’un rire impertinent, préfère laisser une carte portant « pour condoléances », mention qui alors qu’il l’écrit se transforme en « pour féliciter ».
À la suite de la narration du rêve, le patient reconnaît que ses allées et venues correspondent à la crainte d’être rossé. Puis, ajoutant qu’il pense que Freud maintenant va le flanquer à la porte, il associe sur une image où son analyste et la femme de celui-ci sont couchés avec un enfant mort entre eux. Vient alors un souvenir datant de ses cinq ou six ans où il est ainsi couché entre son père et sa mère : il mouille le lit et son père le rosse et le flanque dehors. Freud écrit ensuite : « Sa mimique pendant tout ce temps est celle d’un désespéré, de quelqu’un qui veut se protéger contre des coups d’une violence démesurée; il cache sa tête dans les mains, s’éloigne en courant, se couvre la figure avec un bras, etc. » : il ordonne à Freud de lui amener sa fille, désignée comme fille de maison de joie (calembour sur le nom de son analyste), pour la lécher, tout en disant : « Amène le Miessnik (le laideron) », terme masculin qu’il associe ensuite sur une histoire où il s’agit de sauver un garçon de café ainsi appelé. »
Cette séance témoigne du surgissement de la jouissance pulsionnelle qui, en s’organisant aux fins de la jouissance de l’Autre, assigne au « sujet » la position passive du masochisme érogène et a pour effet de l’offrir à la cruauté inexorable de l’Autre.
La jouissance pulsionnelle engendre facilement cette conception d’un Autre absolument cruel auquel chacun doit s’offrir sans retenue. Dès que la moindre demande est supposée dans le discours d’un représentant de l’Autre, il faut y répondre au-delà même de ce qui serait demandé, comme le montre la passion de l’assujettissement à une autorité qu’elle soit amoureuse, intellectuelle, professionnelle ou politique. « Même l’autodestruction de la personne, écrit Freud, ne peut se produire sans satisfaction libidinale. Ce qu’il avait déjà souligné dans Deuil et mélancolie : « La torture que s’inflige le mélancolique indubitablement lui procure de la jouissance.
Mais, cette cruauté supposée de l’Autre est inscrite dans la logique même du fantasme où un énoncé produit l’Autre comme appétit de jouissance et lui attribue un corps marqué d’un manque que le « sujet » se propose de combler.
Nous prenons ainsi la mesure de l’opposition qui s’institue entre l’arrièreplan de la communauté linguistique qui détermine le discernement de ses membres comme l’organisation de leur monde et le fantasme où s’articulent pour chacun les modalités de sa jouissance dans son rapport singulier à l’Autre. Pour reprendre le mot de Freud : nos conduites se déploient toujours entre discernement, Erkennen, et jouissance, Agierenwollen, entre les usages de la communauté et les particularités du symptôme.
Ainsi, un patient était venu me trouver pour un symptôme somme toute assez banal : il ne savait pas très bien s’il devait se marier, voire faire un enfant, avec la jeune femme qui partageait sa vie depuis des années. Peu à peu apparaît que s’il vit bien avec cette jeune femme depuis des années, il se « débrouille » pour ne pas lui faire l’amour, non qu’il n’en aurait pas envie, mais que chaque fois que l’occasion se présente ou du moins que l’occasion est induite par cette jeune femme, il trouve mille prétextes pour se dérober. Il ne peut pas. À la place, à chaque fois, il est pris d’une soudaine envie d’aller aux toilettes où il évacue des selles abondantes. Puis, abattu par la honte, il revient vers sa compagne et se livre devant elle à un rituel de pénitence où il se flagelle avec une ceinture et se mortifie en s’injuriant. Alors son amie, devenant partie prenante du scénario, le console. Après quelques instants, des caresses sont échangées et ils se masturbent réciproquement. Il n’a jamais pu parler avec sa compagne de ce rituel qui s’était imposé à lui depuis le début de leur relation et auquel elle participait sans mot dire, avec cependant, put-il ajouter, une certaine lueur de satisfaction dans le regard de le voir humilié.
La jouissance pulsionnelle, pour reprendre les termes de Freud, nous pousse ainsi « sans répit en avant » et heurte, pour le moins, l’idée d’harmonie; c’est l’ubris, la pleonexia : « Après avoir donné licence au juste aussi bien qu’à l’injuste, écrit Platon, nous les prendrions sur le fait d’aller au même but en raison de la convoitise du plus, de cette fin qu’il est naturel à tout être de poursuivre comme un bien, tandis que par contrainte la loi l’en détourne » (Rép. II, 359c). Le mot de Platon est très perspicace : seule la loi fait limite au plus. Mais, comment ?
D’une certaine manière, c’est la première fonction de la jouissance phallique que de venir mettre une limite à cet appétit indéfini de l’Autre. Or, cette introduction d’une deuxième jouissance s’établit sous l’effet du rapport de la mère au père, rapport qui institue justement quelque chose de la loi. La fonction du père n’est rien d’autre que l’opération où l’enfant est délivré d’avoir à se livrer sans réserve à la jouissance de l’Autre.
En ce cinquantième anniversaire jour pour jour du discours de Rome qui, 53 ans après la Traumdeutung, a constitué un renouveau de la psychanalyse, je conclurai avec Lacan : « La psychanalyse si elle est source de vérité l’est aussi de sagesse. Toute sagesse est un gay savoir. Elle s’ouvre, elle subvertit, elle chante, elle instruit, elle rit. Elle est tout langage. Ouvrez aussi vos oreilles aux chansons populaires, aux merveilleux dialogues de la rue… Vous y recevrez le style par quoi l’homme se révèle dans l’homme et le sens du langage sans quoi vous ne libérerez jamais la parole » Lacan, Rome, le 26 septembre 1953 (Autres Écrits, p. 146).