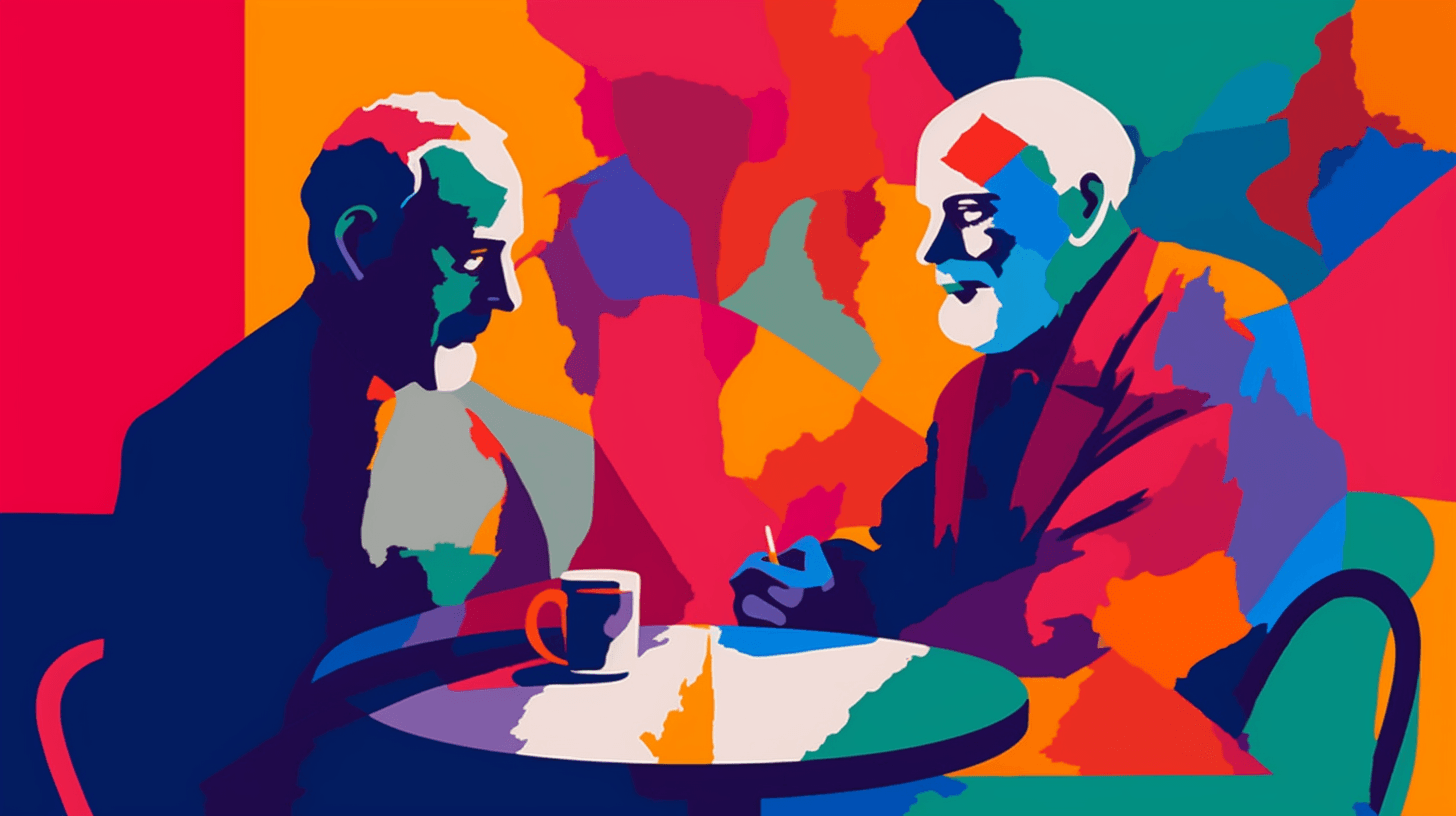Le mouvement féministe contemporain tel qu’il s’est cristallisé autour du mot d’ordre #METOO s’est notamment concentré autour du combat contre les violences sexuelles infligées aux femmes. Il est certes problématique de réduire chaque « vague » du féminisme à une cause paradigmatique (le droit de vote, l’avortement, maintenant les violences sexuelles), comme si la lutte s’arrêtait à des revendications identifiables alors qu’elle déborde souvent tous les cadres que la politique classique tente de lui assigner ; mais justement, dans cet article, Pierre Marie cherche à interroger historiquement la notion de violences sexuelles. Il montre ainsi que ces dernières n’ont pas toujours existé de la même façon, de même que les luttes pour les combattre. Il participe de la sorte à saper la vision progressiste de l’histoire selon laquelle nous progressons depuis toujours vers une émancipation tendanciellement toujours plus grande.
Le surgissement de « #METOO » est un événement hors du commun, dont la portée civilisationnelle oblige à revoir nos catégories de pensée habituelles ; même les féministes « historiques » n’arrivent à le penser n’y voyant que sa dimension d’excès mais qui ne l’épuise puisqu’est en jeu la violence sexuelle infligée aux femmes.
Pour la première fois l’accent est mis non sur l’absence de prise en compte par la société des capacités politiques, juridiques, intellectuelles des femmes, revendications des féministes « historiques », mais sur l’absence de prise en compte par la société de la violence sexuelle subie par les femmes, violence qui s’exerce partout, dans la rue, la vie professionnelle, la vie privée, sorte de banalité qui échappe au regard de tous.
Cette banalité de la violence sexuelle n’est pas sans faire écho à un constat de Freud sur la virilité impétueusedes hommes de notre société à laquelle il donne le nom de protestation virile, comme si facilement les hommes ne pouvaient s’empêcher de jouer une virilité imaginaire s’exprimant à travers une sexualité qualifiée par Freud du plus commun des ravalements où les femmes se retrouvent réduites au rang d’objet et ne sont nullement appréhendées comme sujet. Cette virilité impétueuse est-elle intrinsèque ou induite ? Or, il semble que les hommes de sociétés d’hier et d’ailleurs manifesteraient un certain respect de la dignité sexuelle des femmes.
Cette virilité impétueuse serait-elle, comme il est souvent affirmé, le corrélat d’un masochisme féminin ? Mais, un tel masochiste est-il intrinsèque ou induit ? Là aussi, l’observation des femmes de sociétés d’hier et d’ailleurs montre que ce masochisme est circonstanciel, lié à notre société.
« #ME TOO » vient donc questionner l’aveuglement de notre société et de ses membres à la banalité de la violence sexuelle subie par les femmes, mais « #ME TOO » vient aussi questionner les modes d’identification que notre société propose aux hommes et aux femmes, aux uns une virilité impétueuse, aux autres un masochisme résigné.
Questionnement difficile à entendre pour la plupart d’entre nous. Comment, nous n’avions pas vu ? Comment, nous n’arrivons pas à voir ? Mais, c’est que nous voyons et agissons toujours à partir d’un arrière-planculturel, dans une forme de vie partagée et qu’il ne peut en être autrement. Quel colon au cours de la colonisation française en Afrique était outré du traitement réservé aux « indigènes » ? Quel parisien était révolté à l’aube du 16 juillet 1942 par les arrestations massives d’enfants, de femmes et d’hommes portant une étoile jaune sur la poitrine ? Qui aujourd’hui est indigné par les conditions des migrants ou les lock-out consécutifs aux délocalisations d’usines ? Tout au plus, on détourne la tête et l’on se dit : ça ne me regarde pas, expression intéressante qui est celle de l’interpellation de Bossuet dans son sermon sur L’éminente dignité des pauvres ou celle d’Ivan Karamazov dans son poème du Grand Inquisiteur.
Nous ne pouvions voir la violence sexuelle infligée aux femmes ou nous pouvions la penser naturelle, considérant qu’elle avait toujours été et qu’elle était partout, tout simplement parce qu’elle n’était pas un fait isolé : « Tiens, le voisin bat encore sa femme », mais une réalité ordinaire : une main aux fesses dans le métro, une blague grivoise au café lorsqu’une jeune femme y entre, un commentaire d’un responsable à sa subordonnée sur ses capacités sexuelles, une manière de faire l’amour indifférente aux attentes de sa partenaire, quand bien même sait-on vaguement qu’il y a des sociétés où cette violence est absente, sociétés lointaines : Moso, Minangkabau, Touareg, etc. ou passées : Égypte antique, Scythie, Inde (Lois de Manu), Afrique ancienne (Léonora Mialo lui a consacré un livre), etc., mais cela nous paraît, disons le mot : « folklorique ».
Pour saisir cette importance de l’arrière-plan dans la constitution du regard, il suffit de se souvenir que la qualification de violence sexuelle dans le monde gréco-romain n’était retenue que si elle touchait une femme libre épouse ou fille d’un patricien, à l’exemple du viol de Lucrèce par Sextus Tarquin, non si elle portait sur une femme étrangère ou esclave, au point que l’exquis Art d’aimer d’Ovide concerne seulement la séduction de la femme libre se prêtant au 1er siècle au jeu de la courtisane.
La cécité des féministes « historiques » sur la violence sexuelle infligée aux femmes est ainsi celle de tous ; elles ne pouvaient voir ce que personne ne voyait d’autant plus que leur regard portait et porte encore sur une iniquité objective : la différence qu’instituait la société moderne entre les capacités politiques, juridiques et intellectuelles attribuées aux hommes et celles attribuées aux femmes, dans un contexte demeuré malgré tout jus naturaliste : les fameux droits de l’homme admis
comme allant de soi depuis Thomas d’Aquin puis l’École de Salamanque.
Car cette différence instituée par la société est récente concomitante de l’apparition du droit positif comme lors du Bill of Rights de 1689 (Glorious Revolution), du Bill of Rights de 1776 (Virginie) ou de la Révolution en France : des droits admis, politiques, juridiques et intellectuels, y furent mis en cause et les femmes y perdirent leurs capacités politiques, juridiques et intellectuels.
Le statut de minorité politique fut donné aux femmes par l’Assemblée du 22 décembre 1789 et fut repris dans la Constitution du 3 septembre 1791 : elles furent exclus du corps électoral (ni électrices ni éligibles).
Le statut de minorité juridique fut donné aux femmes par le Code Napoléon de 1804 : elles ne purent ni ester en justice ni gérer leurs biens, ni diriger une entreprise.
Ces deux premières incapacités furent adoptées par le pouvoir législatif sur le conseil du docteur Pierre Roussel et de son Système physique et moral de la femme.
Restait à assurer leur déclassement cognitif : il fut instruit par le docteur Pierre Cabanis avec ses Rapports du physique et du moral. S’ensuivit l’effacement de la question de l’éducation des filles laissée aux soins des familles jusqu’en 1836 où un enseignement primaire portant sur les travaux ménagers leur fut proposé par les communes importantes auquel fut ajouté 30 ans plus tard un enseignement professionnel technique pour former les futures ouvrières. Passer le baccalauréat, faire des études supérieures leur était alors non seulement impossible par le biais d’un établissement qui les y aurait préparées mais requérait encore l’autorisation du père ou du mari : ce fut par un concours de circonstances heureuses que Julie Daubié arriva à passer le baccalauréat en 1861 et Madeleine Brès à s’inscrire en faculté de médecine en 1868.
Or, jusqu’à la Révolution Française, surtout jusqu’au XVIIe siècle, les femmes pouvaient diriger un fief, participer aux États-Généraux, ester en justice, gérer leurs biens, comme elles pouvaient penser, écrire à l’exemple des très nombreuses femmes écrivaines entre les XVe et XVIIe siècles de Christine de Pisan à Madeleine de Scudéry.
Mais, la violence sexuelle infligée aux femmes ?
Contrairement à l’histoire récente du féminisme regroupée sous l’appellation de féminisme « historique », des Suffragettes au MLF, cette violence fut prise en compte très tôt dans la réflexion des premiers temps du christianisme, non seulement parce que Paul affirma d’emblée qu’il n’y avait pas de différence entre Juifs et Grecs, esclave et homme libre comme entre homme et femme (Ga 3,28), pas de différence au regard de l’eschatologie et donc pas de différence au regard de la dignité, précision qui semble avoir été admise sans trop de difficulté par les premières communautés chrétiennes d’autant plus que simultanément fut valorisée la chasteté (les noces célestes) aux dépens de l’amour terrestre (martyre de sainte Cécile, de sainte Agnès, etc.) et donc pour de nombreuses femmes la possibilité d’échapper à la tutelle d’un père ou d’un mari par le choix de la vie monastique, ouvrant l’opportunité d’une vie intellectuelle comme de création à l’exemple d’Hildegarde de Bingen ou d’Héloïse, choix de vie qui s’amplifia à partir du XIe siècle, de sorte que très vite se multiplièrent tant le nombre de monastères féminins que les nouveaux modes de vie collectifs à l’exemple des béguinages.
Mais, la christianisme ne s’arrêta pas à la vie consacrée ; très tôt, il élabora, pour les femmes entrant dans la vie conjugale tant l’obligation du consentement que l’obligation de la volupté partagée : « Que le mari rende à la femme ce qu’il lui doit » (Paul, repris par Thomas d’Aquin). Pour le christianisme, le consentement de la femme au mariage est obligatoire et doit être recueilli par le prêtre comme l’Éros féminin doit être respecté par le mari (cause d’annulation du mariage). C’est la grande révolution du IVe Concile de Latran (1215) : les femmes ont le droit absolu d’être respectées.
La lutte des femmes contre la violence sexuelle prit tôt appui sur l’Église et sur sa double exigence du consentement et de la volupté partagée, double exigence qui témoigne a contrario de la violence sexuelle subie par les femmes.
Cette lutte des femmes appelée aujourd’hui la Querelle des femmes débuta avec la réplique de Christine de Pisan à la fin du XIVe siècle dans son Épitre au Dieu d’Amours et dans son Dit de la rose à la deuxième partie du Roman de la Rose rédigée par Jean de Meung à la fin du XIIIe siècle où la femme n’était plus l’objet de l’amour courtois et n’y était donc plus élevée au rang d’idéal respecté, le fin’amor, comme dans la première partie du Roman rédigée par Guillaume de Lorris, mais où elle était ravalée.
Si cette idéalisation de la femme se poursuivit, ainsi chez Dante ou Pétrarque, la littérature misogyne aussi. Et quand un pape, Pie II, faisait l’éloge de l’Éros féminin, c’était en 1470 avec la publication de l’Histoire des deux amants, un autre pape, Innocent VIII, le dénonçait en le taxant de manifestation du diable, c’était en 1484 avec la bulle : Summis desiderantes affectibus, « Désireuses d’ardeur suprême ».
Deux ans plus tard paraissait à Strasbourg le manifeste même de la misogynie : le Malleus maleficarum, le Marteau des sorcières, de Jacques Sprenger et Henri Institoris, aussitôt condamné par l’Église, mais dont la conséquence fut le martyre de plusieurs dizaines de milliers de femmes…
Vraisemblablement, cette folie misogyne qui se répandit à partir du XIIIe siècle était liée au changement progressif du statut économique et culturel des femmes. Avec le développement des villes et des activités d’artisanat (tissage) et de commerce, les femmes s’autonomisèrent économiquement avec pour conséquence l’apparition du vêtement féminin (avant elles s’habillaient comme les hommes). Les femmes devinrent coquettes, leurs vêtements furent faits de tissus raffinés, la taille y était marquée et un décolleté offrait leurs seins aux regards. Elles se fardaient, se parfumaient. L’épilation pubienne se répandait. Mais, les femmes accédaient aussi au savoir et à la création (Christine de Pisan), voire à la capacité militaire (Jeanne d’Arc) ; elles inventèrent une nouvelle grammaire de la volupté mêlant érotisme et art, voire pouvoir.
Si cette nouvelle grammaire de la volupté de l’Éros féminin se fit entendre, malgré l’ambiguïté de Boccace, dans le Décaméron écrit vers 1350, elle fut exposée par Agnès Sorel, la favorite de Charles VII, qui en fit un art de vivre.
Toutefois, ce furent des femmes écrivains qui exposèrent au mieux cette nouvelle grammaire : Hélisenne de Crenne dans ses Angoysses douloureuses qui procèdent d’amour (1538), Pernette du Guillet dans ses Rymes (1545), Louise Labé dans ses Élégies et Sonnets (1555), Marguerite de Navarre dans son Heptaméron (1559).
La réaction misogyne n’en fut que plus vive : Baldassar Castiglione avec son Livre du Courtisan : la femme doit s’égaler à la femme rêvée par l’homme (1528) ; Gratien du Pont de Drusac avec ses Controverses des sexes masculin et féminin (1533) ; Jeanne Flore (pseudonyme d’Étienne Dolet) et ses Contes amoureux (1537) ; Bertrand de la Borderie et son Amye de court (1541) ; Jean de Marconville et sa Bonté et mauvaiseté des femmes (1563) ; etc. Même les Sonetti lussuriosi, les Sonnets luxurieux, et les Ragionamenti de L’Arétin ont un fumet de misogynie ; et que dire des Vies des dames galantes de Brantôme.
Puis, l’expression de l’Éros féminin prit fin sous la pression de la Réforme puis de la Contre-Réforme. Seule solution pour se prémunir de la misogynie, fustiger le mariage et faire l’éloge du célibat, à l’exemple d’Élisabeth 1re d’Angleterre, de Marguerite de Valois, de Marie de Gournay ou de Madeleine de Scudéry.
Au demeurant, cette misogynie s’illustra encore dans les romans libertins du XVIIIe siècle, même sous la plume d’un auteur aussi « favorable » aux femmes que Diderot, à preuve Les Bijoux indiscrets où les femmes y étaient réduites à un sexe avide de plaisirs mais indifférent à qui les apportait. Et que dire de la misogynie des romans de Sade, l’inventeur du concept de décharge.
Seule Madame de Merteuil, l’héroïne de Choderlos de Laclos, vit alors cette misogynie et la violence qu’elle infligeait aux femmes.
Puis, cette violence, je l’ai déjà souligné, trouva à se légitimer auprès des médecins du XVIIIe siècle. Sûrement que la conscription inventée en 1793 et devenue la règle en 1798 en valorisant au sein d’une communauté exclusivement masculine une virilité sur-jouée contribua aussi à son inscription naturaliste. S’installa alors une invisibilité de la violence infligée aux femmes car les hommes de génération en génération l’implémentèrent et elle devint leur agir commun à l’égard des femmes qui elles-mêmes la prirent peu à peu pour naturelle, sorte d’essentialisme à ce point admis que même les féministes « historiques » du XXe siècle ne la virent pas.
Que les femmes depuis la Révolution n’aient été que des corps livrés à l’entretien du ménage, à la procréation et à l’éducation des enfants, n’a fait qu’induire chez elles la propension à consolider les usages sociaux par la valorisation des petits garçons aux dépens des petites filles, renforçant chez les premiers la protestation virile et chez les secondes le masochisme attendus par la société.
Que les femmes ne fussent que des corps livrés à la procréation nous rappelle que l’avortement et donc la libre disposition de leur corps fut interdit par le Code Napoléon de 1810 et le resta jusqu’à la loi Veil de 1975, alors qu’il n’était pas vraiment réprimé dans l’Ancien Régime de même que l’infanticide très fréquent. Quant à la contraception, du moins sa propagande, elle fut interdite par une loi de 1920 : la vie de la femme était réduite à celle de la mère -la fête des mères fut inventée peu après.
Cette invisibilité de la violence infligée aux femmes oblige à reprendre le concept d’Hannah Arendt de banalité du mal : c’est dans le quotidien, dans l’ordinaire du quotidien, que se manifeste cette violence et pourtant nul ne la voit, elle est dans les usages, les usages en témoignent sans pour autant qu’elle fasse relief : c’est comme ça.
Les hommes de notre culture commettent cette violence sans la penser et sans la voir ; ils sont agis par les usages qui les empêchent de saisir la portée de leur acte. Qu’une femme, y compris leur partenaire, ne soit au fond qu’un objet destiné à leur décharge, en quoi cela serait problématique ? Il n’est alors peut-être pas étonnant que celui qui a inventé cet emploi du mot « décharge », Sade, ait écrit son œuvre justement au moment où le ravalement des femmes étaient une chose collectivement acquise ; Sade par son naturalisme absolu est le complice inavoué des docteur Pierre Roussel et Pierre Cabanis et nous dit déjà le destin assigné aux femmes dans une anticipation que viendra confirmer le cinéma pornographie.
Mais, dirons les esprits chagrins, n’y a-t-il pas quelques excès à #ME TOO ?
Alors, est-ce que la Terreur était inévitable ? Les aristocrates convoqués au Tribunal Révolutionnaire ne comprenaient nullement les raisons de la vindicte populaire car pour la plupart ils n’avaient commis aucun forfait au regard des lois en vigueur jusqu’au 4 août 1789 et comme une loi n’a pas de valeur rétroactive, en quoi pouvaient-ils être considérés comme coupables ? Ils oubliaient qu’eux et leurs familles avaient bénéficié depuis plus d’un millénaire de privilèges iniques reposant sur des usages que la diffusion du droit naturel depuis le XVe siècle mettait en cause en engendrant une colère longtemps retenue par des générations de paysans, d’ouvriers et de bourgeois qui en faisaient les frais. Pourquoi ces derniers avaient dû assurer des corvées au seigneur et lui payer aussi la taille, le cens, le champart, les droits de banalité, etc. ? Qu’avait-il de différent d’eux ? Ah, il avait un statut alloué de toute éternité parce qu’il était le fils d’un seigneur qui lui-même tenait ce statut de son père, etc., statut obligeant de surcroît les paysans, les ouvriers et les bourgeois à une déférence, en sus des corvées et des divers impôts, qui, au-delà des marques de respect, impliquait l’acceptation qu’à l’église des sièges fussent réservés au seigneur ou que le seigneur ait le monopole de la chasse, etc.
Le « monopole de la chasse », l’expression tombe bien, car c’est au nom d’un supposé « monopole de la chasse » sexuelle que #ME TOO s’est déployé…
La Terreur était peut-être indispensable pour que soit vu ce qui était absolument invisible.
La société doit désormais voir et faire en sorte que quelque chose change dans l’éducation des garçons et des filles, que les premiers apprennent à respecter la dignité des femmes et que les secondes apprennent à dire non. Ce n’est pas qu’une affaire de consentement, c’est une affaire d’égard. Si d’autres sociétés avaient réussi ce pari, voire si d’autres sociétés le réussissent, comment notre société ne le pourrait ? Demeure la volonté collective, voire politique, d’y contribuer.